
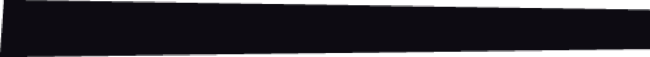
pourquoi les récits de vie
Bruits du temps
une aventure
« C’est l’oubli des vivants qui fait mourir les morts. »
Auguste Comte
« Je ne peins pas l'être, je peins le passage. »
Michel de Montaigne
« Un homme, c'est toute l'époque, comme une vague est toute la mer. »
Sartre, Situations
Pourquoi les récits de vie
Je dirais qu'il n'y a pas un chemin qui m'ait conduit à réaliser des récits de vie, mais plutôt une conjonction de chemins dont le carrefour serait l'élaboration de mémoires. Ma relation à l'écrit et mon goût pour le témoignage et l'histoire du XXe siècle en est la clé de voûte : des études littéraires, l’exercice du métier de libraire, et un travail personnel d'écriture depuis l'adolescence. Ensuite, il y a ma relation forte à l'image qui m'a été transmise en ligne directe par mes parents tous deux photographes. Je puis dire que je suis quasiment né un appareil photographique à la main ! Et puis il y a eu les images animées, la réalisation de courts-métrages, les tables de montage qui occupaient une partie de mon temps libre.
Ensuite m’est très vite venu un goût immodéré pour le cinéma, et particulièrement pour le film documentaire. J'affectionne les portraits, pas nécessairement de personnages célèbres d'ailleurs, mais d'anonymes dont on peut soudain sentir une étonnante proximité alors que leur parcours de vie semble de prime abord si éloigné du nôtre.
Tout cela m'a conduit – lorsque les circonstances ont voulu que je redéfinisse mon parcours professionnel, à m'orienter vers les récits de vie. Et j'ai rapidement senti, alors que j'avais d'abord commencé par faire des livres, qu'il me fallait adjoindre de l’audiovisuel. Le livre étant le support idéal pour un long développement, et le film permettant non seulement d'intégrer toutes sortes de documents, des photographies et des films familiaux qui ont jalonné toute existence, mais aussi d'immortaliser les expressions, les rires, la voix propres à chaque personne.
Mon travail consiste donc à recueillir des souvenirs par le biais d'entretiens filmés. L'intégralité des entretiens est alors retranscrite, agencée et mise en forme, puis soumise à une relecture par le narrateur qui peut développer, retrancher ou ajouter à sa guise. Mais je tiens tout particulièrement à préserver la singularité, le grain particulier de chaque voix, son rythme singulier. L’exercice consiste à se fondre au plus près de la vie de la personne interviewée qui doit avoir la sensation que c’est elle seule qui a écrit le livre. Le film est quant à lui constitué d’un montage extrêmement méticuleux à partir des entretiens auquel s'ajoutent quantité de documents familiaux – mais également d’archives historiques –, de photographies, de films, de lettres, enfin, de tout ce qui pourrait venir enrichir le récit. Je me refuse à utiliser des canevas prédéterminés, car je tiens à trouver pour chaque récit sa propre forme, avec son souffle propre, celui que je sens en correspondance avec le narrateur. Il me semble que cela nécessite, avant toute compétence formelle, technique, une forte dose d’empathie.
« La mémoire, ce n'est pas seulement une quête personnelle.
C'est un travail sans fin pour la mise en ordre et l'architecture du monde. »
Jean-Marie Gustave Le Clézio
(entretien dans Le Nouvel Observateur
à propos d'Un rocher sur l'Hudson de Henry Roth)
« La réalité ne se forme que dans la mémoire. »
Marcel Proust
Les souvenirs
De même que les archéologues reconstituent des civilisations disparues à partir de vestiges, de fragments éparpillées, mon travail consiste à recueillir des bribes de mémoire, à les recomposer, à les assembler pour en restituer une énergie, plus qu’un reflet, la plus fidèle possible de ce que fut cette vie. C'est comme une archéologie du vivant, en quelque sorte. Quel que soit le souvenir exhumé, fut-il parcellaire, il appartient au flux de ce que nous avons vécu, — c'est cela qui refait surface à l’instant où l’on raconte. Et incorporé à un mouvement plus ample, il deviendra représentatif à son tour et au même titre qu’une remémoration plus précise et à priori significative. Walter Benjamin écrit que « la véritable mesure de la vie est le souvenir ». Cette trace d'existence la sauve de l'engloutissement dans l'oubli. Elle produit du légendaire afin d’enrichir la transmission, génération après génération, comme un passage de témoin. C'est, je crois, ce qui confère au patrimoine familial sa valeur la plus immatérielle mais aussi la plus précieuse.
Henry Roth dans Un Rocher sur l'Hudson, l'un des volumes de ses mémoires, notait que le cri de chaque être humain a toujours été : « Et quand je me désagrégerai, qui se rappellera ? » Et Milan Kundera, dans un entretien avec Philip Roth en 1980, affirmait que : « Ce qui nous terrifie dans la mort, ce n'est pas la perte de l'avenir, mais la perte du passé… »
Le parcours d'une vie
Par ailleurs, je suis convaincu qu'il n'y a pas de parcours banal. Aucune vie n'est insignifiante et ce ne sont pas seulement ceux qui ont accompli des « choses mémorables » qui ont eu une vie bien remplie. Comme l'écrivait Montaigne dans ses Essais, les grands de ce monde font quotidiennement la même chose que nous : ils dorment, rêvent, mangent, travaillent, aiment et haïssent, doutent et espèrent, éprouvent la même gamme de joies et de peines.
« L'anecdote contient souvent l'essence d'une vie », disait George Steiner dans un entretien d’À voix nue avec Laure Adler sur France Culture. Tout cela forme un puzzle désordonné que j’ai pour mission d’assembler afin d’en dégager une cohérence, une lisibilité. Là où l’on ne voyait que des décombres, on aperçoit un palais aux multiples pièces. Car ce que génère le travail finalisé, c’est de l’inattendu. Il en est de même souvent des découvertes scientifiques : ce n’était pas ce que l’on cherchait que l’on a trouvé.
Par un minutieux travail de marqueterie, je tente de réinscrire les souvenirs dans leur contexte, leur quotidienneté, avec tout ce qui fait la vie et ses petits riens. C’est cela aussi qui doit transparaitre. Le monde change à une vitesse telle que ce qui aujourd'hui nous paraît banal, superflu, peut en quelques décennies devenir fabuleux. D’où l’attention particulière que j’accorde aux singularités des mises en scènes de la vie quotidienne.
Pourquoi les récits de vie (2) – le père
J'ai parfois entendu des écrivains dire qu'ils avaient tenté d’écrire le livre qu'ils auraient aimé lire, de même pour les peintres et l’ultime toile rêvée. Quant à moi, – et cet élément autobiographique n'est en rien anodin –, j'ai perdu mon père, qui avait épousé ma mère à un âge déjà avancé, alors que j’étais encore jeune. Il était né à l’étranger, fils unique, et je me suis soudain rendu compte, après sa disparition, que j'étais à jamais dépossédé d'une grande partie de son histoire, impossible à reconstituer, et que cela restera comme une part manquante en moi et pour mes descendants. C'est cette prise de conscience douloureuse qui m'a fait apparaître à quel point il était important de recueillir et d'ainsi sauvegarder, – comme on sauvegarde des données sur un disque dur –, la substance qui dessine une vie. C'est ce qui m’a déterminé dans cette voie. Il est essentiel de savoir d'où l'on vient pour mieux comprendre qui l'on est.
Le passé parle à travers nous
Le passé, travaillé par l'oubli, n'est jamais figé. Bien au contraire, il bouge en nous, travaille en nous et nous travaille, sans que bien souvent nous en ayons ni maitrise ni conscience. Cette mémoire modèle notre présent, s’y inscrit, filtre dans les intervalles de l’oubli. Aussi est-il inexact de dire que le passé est mort.
Et puis, hormis la transmission, il y a aussi cette chance unique de disposer d’un panoramique de sa vie, au sens photographique du terme. Avec ce moment magique de la découverte de cette reconstitution faite des « images que les événements ont gravées dans notre esprit en passant par les sens, comme des traces de leur passage », selon le célèbre Livre XI des Confessions de Saint–Augustin. Car bien que tous les éléments soient connus du narrateur, puisque c'est lui-même qui me les confie, ils ne sont que bris épars qui à terme livrent ce qui fait le contenu d'une vie, d’un accomplissement susceptible de se perpétuer dans les mémoires des générations futures. Cette expérience, qui est toujours une grande joie, une émotion intense, est difficile à décrire. Sans doute y a-t-il ce sentiment que le temps passé ne sera pas irrémédiablement effacé, comme l’écume sitôt disparue, dissoute dans la vague, mais qu’il s'est métamorphosé en traces, en matière d'existence. Je crois que cela peut donner du sens à une vie qui va bientôt prendre fin.
L'échange
La clé de la réussite d'un récit de vie est d'instaurer une relation de confiance. Cette confiance convoque, plus que la curiosité, une réelle empathie. Alors qu’une relation singulière se tisse par l’évidente intimité des récits, la parole se délie tout naturellement. Il faut donc poser les bonnes questions au bon moment, mais surtout être dans une écoute qui, de par son intensité, allume les feux des souvenirs.
Pour conclure
Une de mes plus belles récompenses est venue d'une dame âgée de 95 ans qui a dit à son fils après avoir visionné son film et lu son livre : « C'est le plus beau cadeau qu’on ne m'a jamais fait ! »
•
Saint-Augustin, Confessions, livre XI : « Si donc le futur et le passé existent, où sont-ils ? Je veux le savoir. À défaut d'en être capable pour l'instant, je sais du moins ceci : où qu'ils soient, ils n'y sont pas en tant que futur ou passé, mais en tant que présent. Car si le futur y est comme futur, il n'y est pas encore ; si le passé y est comme passé, il n'y est plus. Et donc, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, ils n'y sont que comme présent. »
Louise-Victorine Ackermann, Pensées d'une solitaire : « Pour écrire l'histoire de sa propre vie, la mémoire ne suffit point, il faut encore l'imagination : j'entends l'imagination du souvenir, non pas celle qui invente, mais celle qui rassemble et ranime. »
